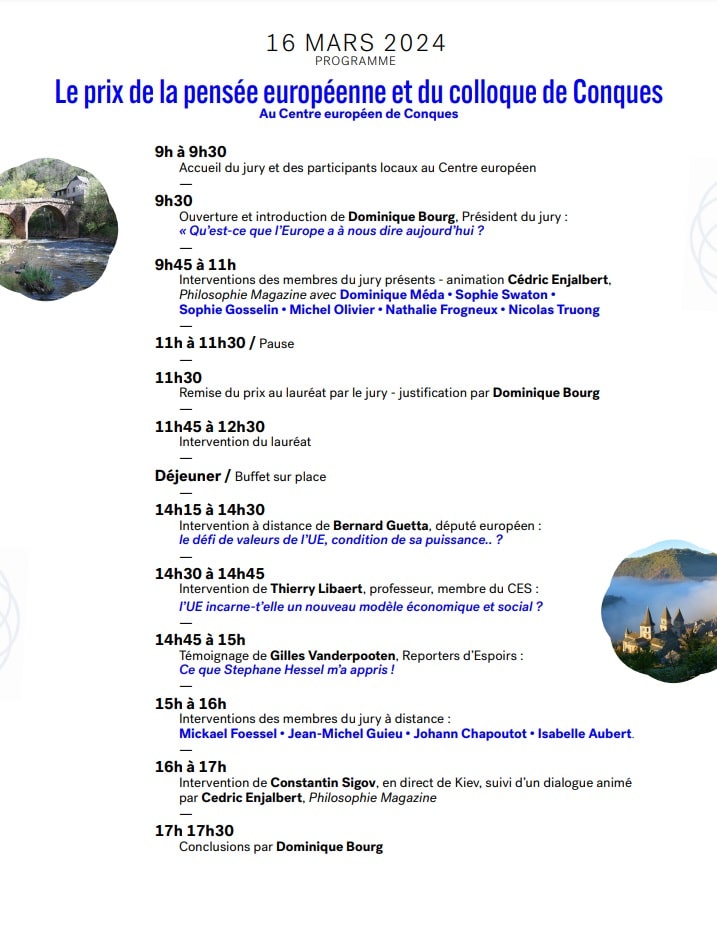Virginie Sassoon est directrice adjointe du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), docteure en sciences de l’information et de la communication, et experte de l’analyse des stéréotypes dans les médias. A l’occasion de la 35ème édition de la Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole qui se tient cette semaine, elle nous livre son point de vue sur la relation entre les jeunes et les médias.
Quel est votre rôle, Virginie ?
Je suis directrice adjointe du CLEMI depuis 4 ans, tout en étant dans l’organisation depuis presque 8 ans. Mon rôle est d’accompagner et de soutenir l’ensemble des projets. De faire le lien entre les enseignants, les chercheurs et les acteurs de l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Engagée sur les projets en coéducation entre les familles et les écoles, je suis à l’initiative de ressources pour les parents- l’univers de « La Famille Tout-Ecran »– ; j’accompagne des concours comme « Zéro cliché » qui lutte contre les stéréotypes de genre en permettant aux élèves de produire des vidéos, des podcasts ou des articles sur l’égalité filles-garçons. Enfin, je m’occupe de partenariats comme celui avec Reporters d’Espoirs.
Pourquoi vous être engagée au CLEMI ?
Au départ, je suis docteure en sciences de la communication et de l’information, ce qui m’a amenée à étudier le fonctionnement des médias et leur impact. J’ai été enseignante et ai fondé une association d’éducation aux images. Cela a mené à la création d’un festival de cinéma pour les enfants avec des ateliers pour qu’ils puissent créer leur propre film. Ayant un jour rencontré une coordinatrice du CLEMI de l’académie de Bordeaux, j’ai tout de suite trouvé l’organisation passionnante. La présence du CLEMI au niveau académique et national est une réelle force pour faire le lien entre l’école et les médias. Cela crée des passerelles pour comprendre la fabrication de l’information, ce qui est essentiel pour garder la démocratie vivante. Quand j’ai su que le CLEMI recrutait, je n’ai pas hésité une seule seconde !
Jeunes et actualité
Comment faire renouer les jeunes avec l’actualité ?
Je ne pense pas que les jeunes soient déconnectés de l’actualité. Ils ont leur propre actualité, qui n’est pas celle du monde des adultes, ni des médias dits traditionnels. Au CLEMI, on essaye de partir des pratiques informationnelles des jeunes pour faire des séances d’éducation aux médias qui soient adaptées à leurs réalités. On mise sur le « learning by doing ». En produisant l’information, les élèves se sentent beaucoup plus impliqués, et cela impacte aussi la manière dont ils la reçoivent. Ce cercle vertueux les rend plus éveillés et plus critiques sur la manière dont ils s’informent.
Quelles sont les projets que vous mettez en place pour y parvenir ?
Le CLEMI a plusieurs missions. Il forme environ 30 000 enseignants par an. On distribue des brochures pédagogiques. Cette année, le dossier de la Semaine de la Presse et des Médias s’intitule « l’info sur tous les fronts », et propose des activités et des analyses pour comprendre l’information en temps de guerre, les enjeux de l’IA, des défis écologiques mais aussi les enjeux liés au traitement médiatique du sport pour cette année olympique. Chaque année, ce dossier est diffusé à grande échelle et permet aux enseignants de réaliser des projets en EMI. On accompagne également la création de médias dans le cadre scolaire : des journaux, des web radios, des web TV, des comptes sur les réseaux sociaux pour des projets éducatifs. Le CLEMI a également la mission d’organiser des évènements, comme la Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole (SPME) qui concerne 4,5 millions d’élèves cette année. La SPME rassemble 1800 partenaires. On organise aussi des évènements comme le concours « Médiatik », le plus grand concours national de médias scolaires et « Zéro Cliché » que j’ai évoqué. La force du CLEMI, c’est son réseau. Des référents dans chaque académie interviennent dans les établissements pour accompagner les équipes éducatives.
Au-delà du CLEMI, des initiatives à saluer ?
France TV organise le Tour de France de l’EMI. Les enseignants participent pendant deux jours à des formations, des ateliers et des conférences avec des journalistes. C’est très riche car ça concerne tout le territoire. La Voix du Nord a lancé son média Ta Voix, qui accompagne des élèves de 13 à 17 ans dans la création d’articles et leur donne une grande visibilité. Plus généralement, je trouve intéressante la manière dont les titres de presse quotidienne régionale ouvrent leur espace pour l’expression des jeunes et leur donnent la parole. De la même manière, on pourrait citer les actions des antennes de Radio France, d’Arte, d’Europe 1, des titres de Bayard, de La croix, de TF1, avec les rencontres de l’info ou encore d’institution comme l’ARCOM…Avec M6 et Gulli, les jeunes choisissent eux-mêmes leurs sujets et les réalisent avec des professionnels. Les sujets sont ensuite diffusés sur les antennes, c’est gratifiant. Il faut saluer aussi tous les médias qui prennent le temps d’accueillir les jeunes et de leur montrer les coulisses de la fabrication de l’information, comme Sud-Ouest ou BFM.
Coopération avec Reporters d’Espoirs
Pouvez-vous expliquer l’initiative d’éducation des jeunes aux médias que nous menons ensemble, CLEMI et Reporters d’Espoirs ?
Avec Reporters d’Espoirs, notre collaboration est née d’une évidence. Nous avons des engagements communs pour transmettre aux plus jeunes une démarche citoyenne qui soit porteuse d’espoirs. Au sein du CLEMI, nous avons deux référentes expertes Caroline Fromont de l’académie de Lille et Elodie Gautier de l’académie de Créteil, déjà engagées dans des démarches de journalisme de solutions avec des enseignants. L’expertise de Reporters d’Espoirs en la matière est venue enrichir les démarches déjà existantes, et leur a donné de la visibilité. L’éducation aux médias s’accorde avec les principes du journalisme de solutions parce qu’il y a un besoin des enseignants de développer une approche constructive et porteuse d’espoirs dans le rapport à l’information pour leurs élèves. Plus globalement, ce partenariat avec Reporters d’Espoirs répond à une nécessité de résister à la fatigue informationnelle et à la morosité ambiante.
Vous œuvrez depuis plusieurs années à la lutte contre les fake news : n’est-ce pas un peu anxiogène pour la jeunesse ?
Très bonne question. Il y a dans l’éducation aux médias une ambition émancipatrice. L’actualité peut être extrêmement anxiogène, cette éducation sert à devenir plus actif dans ses pratiques informationnelles. Elle sert notamment à comprendre les logiques algorithmiques des réseaux sociaux qui ne profitent pas forcément à notre santé mentale. L’éducation aux médias permet aussi de développer un sens critique, c’est un cheminement qui n’agit pas de la même manière sur tout le monde, mais qui permet d’être plus éclairé dans notre rapport à l’information. Ça permet parfois de résister à cette fatigue, à cette anxiété, et de ne pas céder à l’infobésité.
Compléter votre approche par l’apprentissage du journalisme de solutions, est-ce une manière de leur donner des perspectives, de les aider à se projeter dans l’avenir ?
Oui, j’y crois complétement. Pour ne pas se décourager, on a besoin de regarder du côté de celles et ceux qui agissent, qui s’engagent, qui cherchent et qui parfois trouvent. Le journalisme de solutions, ce n’est pas dépeindre une société qui serait idéale, ou regarder le verre à moitié plein tout le temps. C’est une approche qui permet de retrouver un pouvoir d’agir qui est vital, et qui permet surtout de retrouver une confiance dans nos démocraties et dans notre rapport au collectif, à tous les niveaux.
Les jeunes à travers le prisme des médias
Comment jugez-vous le traitement médiatique qui est réservé aux jeunes ?
Même si ça n’englobe pas tous les médias, on peut déplorer les idées reçues sur le fait qu’ils soient tous complotistes, décérébrés ou encore des digital natives surconnectés. Il y a globalement un manque de nuances. « Les jeunes » est une expression qui ne veut pas dire grand-chose car la jeunesse est plurielle. Par exemple, ils s’informent différemment selon qu’ils vivent seuls ou chez leurs parents, selon leurs milieux socioculturels, leurs centres d’intérêts. Il y a une diversité et une complexité de la jeunesse qui n’est pas souvent représentée. Il faudrait leur ouvrir de l’espace, pour leur permettre de se définir eux-mêmes, et les outiller pour qu’ils puissent construire leur propre narratif.
Des émissions et programmes qui vous interpellent positivement ? Que vous recommandez aux jeunes ? Et à leurs parents ?
J’écoute beaucoup la radio, des podcasts et la presse écrite à laquelle j’accède maintenant en ligne. Je trouve que le plus important, c’est d’avoir du plaisir à s’informer. Quand s’informer devient une contrainte, crée de la déprime et de l’inquiétude, il faut agir. Cultiver sa curiosité, partager les contenus qui nous font réfléchir, aller vers des médias qui privilégient le temps long ou la profondeur, comme la revue l’Eléphant ou Le 1. La presse jeunesse avec les enfants est aussi très riche. Que ce soit Phosphore ou Okapi, il y a un souci de la contextualisation et une information conçue à hauteur d’enfants qui est précieuse pour donner le goût de l’info.
Propos recueillis par Maëlle Widmann pour Reporters d’Espoirs

 Dans le studio de France Télévisions installé pour l’occasion, l’animateur belge Thierry Bellefroid (RTBF) reçoit l’auteur de bande dessinée Jérémie Moreau sur le thème « Penser, raconter et dessiner le vivant ». L’animateur décrit son style, fait de couleurs très vives, comme une « grammaire colorimétrique ». L’artiste évoque sa carrière, du fauve d’Or reçu à Angoulême à la découverte de Jean Giono : « Pour la première fois, j’avais l’impression de lire de l’écologie de façon incarnée, magique. ». La mission qu’il se donne ? « Apporter une nouvelle esthétique à l’écologie ». La représenter de manière artistique ne risque pas d’édulcorer le problème pense-t-il, mais au contraire de le rendre « plus fin, plus précis ». Utiliser des couleurs tape-à-l’œil est naturel : « Dans nos ascendances frugivores, on ne pouvait pas s’empêcher de foncer vers les couleurs les plus vives ». Ses dessins veulent aider le lecteur à changer de point de vue : redonner une conscience à la nature et cesser de l’objectiver. Ainsi, son album Le discours de la panthère offre une plongée dans la réflexion animale, étourneau comme bigorneau : « C’était très rafraichissant d’imaginer des histoires pour d’autres corps ». Et si Jérémie Moreau avait trouvé une manière de « donner envie d’écologie », que ne cessent d‘appeler de leurs vœux moult activistes en quête de « nouveaux récits » et de « nouvelles représentations » ?
Dans le studio de France Télévisions installé pour l’occasion, l’animateur belge Thierry Bellefroid (RTBF) reçoit l’auteur de bande dessinée Jérémie Moreau sur le thème « Penser, raconter et dessiner le vivant ». L’animateur décrit son style, fait de couleurs très vives, comme une « grammaire colorimétrique ». L’artiste évoque sa carrière, du fauve d’Or reçu à Angoulême à la découverte de Jean Giono : « Pour la première fois, j’avais l’impression de lire de l’écologie de façon incarnée, magique. ». La mission qu’il se donne ? « Apporter une nouvelle esthétique à l’écologie ». La représenter de manière artistique ne risque pas d’édulcorer le problème pense-t-il, mais au contraire de le rendre « plus fin, plus précis ». Utiliser des couleurs tape-à-l’œil est naturel : « Dans nos ascendances frugivores, on ne pouvait pas s’empêcher de foncer vers les couleurs les plus vives ». Ses dessins veulent aider le lecteur à changer de point de vue : redonner une conscience à la nature et cesser de l’objectiver. Ainsi, son album Le discours de la panthère offre une plongée dans la réflexion animale, étourneau comme bigorneau : « C’était très rafraichissant d’imaginer des histoires pour d’autres corps ». Et si Jérémie Moreau avait trouvé une manière de « donner envie d’écologie », que ne cessent d‘appeler de leurs vœux moult activistes en quête de « nouveaux récits » et de « nouvelles représentations » ? Au même moment, un échange intergénérationnel se tient sur la scène « Bourdonnais ». La journaliste Florence Bouchy (Le Monde) est aux côtés de Denis Baronnet, qui présente l’ouvrage « Il faut enfin que je te dise… », au Seuil Jeunesse. Ce livre est le résultat d’un projet porté par l’association culturelle Le Labo des Histoires, qui anime des ateliers d’écriture dans les établissements scolaires. « On va là où la culture ne passe pas », explique-t-il. Armel Bouloulz, lycéenne, raconte le processus d’écriture de sa lettre, exercice auquel elle s’est adonnée dans ce cadre : « J’ai écrit à mon amie Blanche, car ma lettre fait référence au racisme intériorisé ». Ces ateliers veulent donner une liberté à des jeunes qui se sous-estiment. L’éditrice est convaincue qu’ « il faut changer notre regard sur la capacité des jeunes à écrire, il faut leur donner confiance. ». Un vrai défi pour Armel : « J’étais en quête d’identité pendant la période de l’atelier d’écriture. On doit lire nos textes devant tout le monde. Il faut oser partager ». L’entretien se termine par la lecture de la lettre d’une quinquagénaire qui s’adresse à son corps en alternant amour et haine. Preuve que la relation à son propre physique fait partie des thématiques qui traversent les générations.
Au même moment, un échange intergénérationnel se tient sur la scène « Bourdonnais ». La journaliste Florence Bouchy (Le Monde) est aux côtés de Denis Baronnet, qui présente l’ouvrage « Il faut enfin que je te dise… », au Seuil Jeunesse. Ce livre est le résultat d’un projet porté par l’association culturelle Le Labo des Histoires, qui anime des ateliers d’écriture dans les établissements scolaires. « On va là où la culture ne passe pas », explique-t-il. Armel Bouloulz, lycéenne, raconte le processus d’écriture de sa lettre, exercice auquel elle s’est adonnée dans ce cadre : « J’ai écrit à mon amie Blanche, car ma lettre fait référence au racisme intériorisé ». Ces ateliers veulent donner une liberté à des jeunes qui se sous-estiment. L’éditrice est convaincue qu’ « il faut changer notre regard sur la capacité des jeunes à écrire, il faut leur donner confiance. ». Un vrai défi pour Armel : « J’étais en quête d’identité pendant la période de l’atelier d’écriture. On doit lire nos textes devant tout le monde. Il faut oser partager ». L’entretien se termine par la lecture de la lettre d’une quinquagénaire qui s’adresse à son corps en alternant amour et haine. Preuve que la relation à son propre physique fait partie des thématiques qui traversent les générations. Voilà que notre attention se tourne vers le Pavillon Québécois. Les lettres bleues du mot « Québec » font face à la Tour Eiffel, en témoignage de l’amitié francophone. C’est l’heure de la cérémonie de remise du Prix France-Québec. « On devient écrivain parce qu’on a envie d’utiliser le langage pour faire du vivant », déclare le lauréat, Alain Beaulieu, récompensé pour son livre Le Refuge. Il remercie les associations régionales franco-québécoises, une cinquantaine réparties sur le territoire français. Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, est venu en personne soutenir ce prix qui « contribue au rayonnement de la littérature québécoise au sein de l’hexagone ». La célébration de cette entente pour la francophonie se conclue par le discours de Michel Cotnoir. Le président de la Fédération France-Québec / Francophonie fait forte impression avec sa cravate imprimée de fleurs de lys. L’ADN du Festival du Livre est finalement résumé par le lauréat dans un enthousiaste « Et vive la littérature ! ».
Voilà que notre attention se tourne vers le Pavillon Québécois. Les lettres bleues du mot « Québec » font face à la Tour Eiffel, en témoignage de l’amitié francophone. C’est l’heure de la cérémonie de remise du Prix France-Québec. « On devient écrivain parce qu’on a envie d’utiliser le langage pour faire du vivant », déclare le lauréat, Alain Beaulieu, récompensé pour son livre Le Refuge. Il remercie les associations régionales franco-québécoises, une cinquantaine réparties sur le territoire français. Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, est venu en personne soutenir ce prix qui « contribue au rayonnement de la littérature québécoise au sein de l’hexagone ». La célébration de cette entente pour la francophonie se conclue par le discours de Michel Cotnoir. Le président de la Fédération France-Québec / Francophonie fait forte impression avec sa cravate imprimée de fleurs de lys. L’ADN du Festival du Livre est finalement résumé par le lauréat dans un enthousiaste « Et vive la littérature ! ».