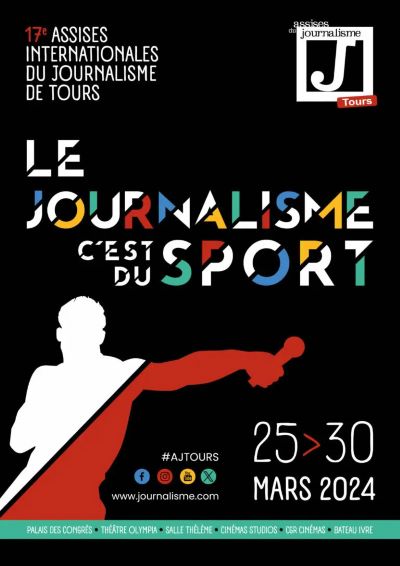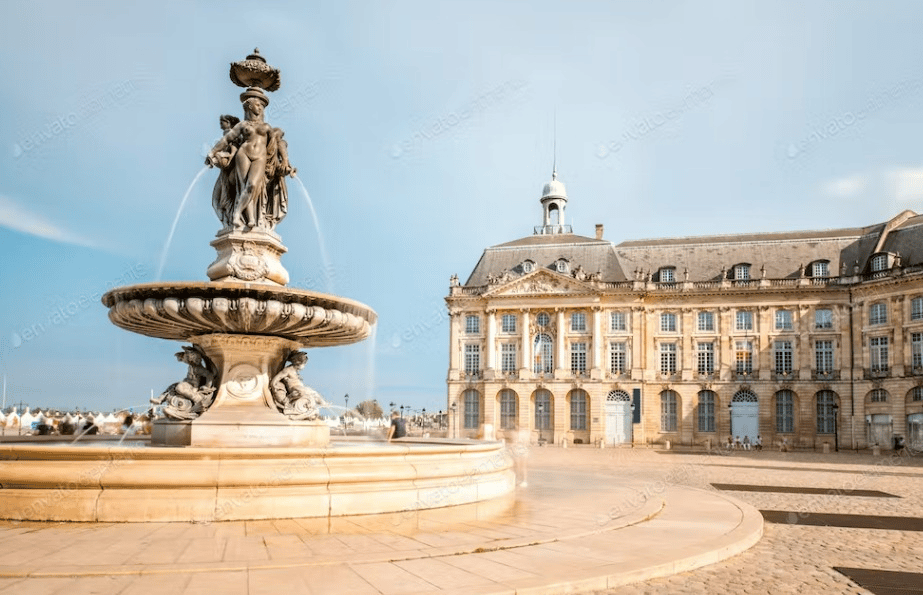Youssef Achour est le président de la société coopérative UpCoop et du groupe Up dont il a gravi tous les échelons ces vingt-cinq dernières années. Patron engagé, élu par les salariés et porté par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, il est aussi président de la CRESS Île-de-France (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire). La Scop* qu’il dirige a rejoint Reporters d’Espoirs comme mécène au début de l’année 2024. Aussi, nous avons voulu l’interroger sur le groupe singulier qu’il dirige, et plus largement sur l’engagement des entreprises de France. Sans oublier de le questionner sur son rapport à l’information.
Tout le monde ou presque côtoie UpCoop au quotidien … mais sans véritablement le savoir. Le chèque déjeuner, c’est vous ! Et ça fait 60 ans que ça dure.
Effectivement, nous avons débuté avec la marque Chèque déjeuner en 1964, qui a démocratisé l’accès à la restauration du midi et permis aux salariés qui déjeunaient à l’extérieur de prendre un repas de qualité dans un lieu de leur choix. Le titre-restaurant, c’est un vrai exemple de ce que le dialogue social dans l’entreprise, entre salariés et direction, permet de construire. C’est le fruit d’un accord obtenu au terme d’une négociation constructive entre partenaires sociaux, et l’impact est positif pour tous. Pour les salariés c’est du pouvoir d’achat additionnel, puisque les entreprises prennent en charge 60% ou 50% de la valeur du titre et pour l’employeur, c’est un levier d’engagement, de cohésion, de qualité de vie au travail et de marque employeur. Nous en sommes très fiers, car le titre restaurant nous a permis de nous ancrer dès le début dans une mission d’intérêt général et d’utilité sociale auprès des entreprises.
Comment un tel produit a pu se mettre en place ?
C’est grâce à la coopération de tous les acteurs. Il faut d’abord un Etat volontaire, qui met en place des mesures incitatives pour que l’entreprise et les salariés trouvent un intérêt commun. Il faut donc des entreprises qui décident, dans le cadre du dialogue social, d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie de leurs salariés. Il faut aussi des restaurateurs, bien entendu, qui accepteront le paiement via ce support. Et pour coordonner le tout, un tiers de confiance : c’est nous ! Notre rôle est d’assurer le bon fonctionnement de tout l’écosystème et des flux qui y transitent. Lorsque le restaurateur reçoit et accepte le titre restaurant, il a confiance car il sait qu’il sera remboursé.
Outre les titres restaurants, qu’y a-t-il derrière ce groupe ?
Désormais, avec la digitalisation du titre-restaurant, on est à 1,2 million d’utilisateurs chaque jour. Avec le temps, nous nous sommes diversifiés en déployant d’autres titres spéciaux de paiement destinés à de l’achat plaisir-cadeau comme UpCadhoc par exemple : longtemps, les entreprises offraient via leur comité d’entreprise des paniers-cadeaux présélectionnés. Maintenant, avec le titre UpCadhoc, le salarié achète le cadeau qu’il souhaite offrir, ce qui donne une plus grande liberté. Nous avons élargi le dispositif à d’autres secteurs, comme ceux de la culture, du sport, de la lecture et de l’action sociale.
Ce que l’on connait moins, c’est toute l’activité qui nous permet d’accompagner les pouvoirs publics, collectivités et associations dans le versement des aides sociales aux personnes les plus démunies par exemple, de manière ciblée et sécurisée. Et nous nous sommes aujourd’hui déployés dans 25 pays.
Il y a tout juste deux ans, vous appeliez, avec Biocoop, à la création d’un chèque alimentaire « qui permette aux plus démunis d’accéder à une alimentation de qualité tout en préservant leur liberté de choix dans la consommation ». Où en est-on ?
Cela fait des années qu’on travaille sur l’idée du chèque alimentaire. Selon nous, l’Etat doit donner à chacun la possibilité d’accéder à la société de consommation. On imaginait un produit qui serait commandé par les collectivités locales pour être distribué aux personnes en situation précaire ou fragile. L’idée est de répondre au droit fondamental à se nourrir, en laissant la liberté aux bénéficiaires d’acheter dans n’importe quel commerce, ce qui permet au passage d’éviter la stigmatisation des files d’attentes aux banques alimentaires. On a d’abord testé le dispositif à l’échelle locale, puis travaillé avec Biocoop pour l’élargir au plan national. Nous avons voulu montrer la faisabilité du dispositif, pour que le gouvernement s’en empare et le généralise – comme l’avait annoncé le Président de la République en 2022. Hélas, le ministère de l’économie et des finances a décidé d’enterrer ce dispositif. Pour UpCoop, les expérimentations locales continuent, notamment à Dijon, à Montreuil et dans le Gers, mais il n’y a plus – pour l’heure – l’ambition politique nationale que nous espérions.
Vous dirigez la plus grande SCOP – société coopérative et participative – de France. A l’heure où l’on parle de partage de la valeur, et d’augmentation des salaires face à l’inflation, c’est un modèle qui fait la différence pour les salariés ?
Nous sommes la plus grande SCOP de France en termes de chiffres d’affaires, avec près de 750 salariés- coopérateurs de l’entreprise. Ils participent au processus de gouvernance, à la prise de décision, élisent le conseil d’administration parmi leurs pairs et 45% du résultat leur est redistribué.
C’est un exercice complexe mais passionnant que de perpétrer ce modèle de groupe coopératif. Il faut une volonté et une vision politique. Il faut aussi faire cohabiter ceux qui n’ont pas les mêmes intérêts ni le même statut dans un même groupe composé au global de 3 250 salariés. En se développant à l’international, le groupe a repris des entreprises dont les salariés n’ont pas la culture coopérative. Prenez nos filiales dans les pays de l’Est par exemple : ces entreprises, marquées par leur histoire, ne tiennent pas à redevenir des coopératives car cela ne leur évoque pas que de bons souvenirs. Cela ne nous empêche pas de les inciter à développer à la fois la place du dialogue social et la concertation en invitant des salariés à participer à leur conseil d’administration. Là où il faut généralement 1000 salariés dans une entreprise pour que ces derniers soient représentés au Conseil d’Administration, chez nous, les salariés ont des représentants qui participent aux instances y compris dans nos petites filiales.
Se crée-t-il encore des SCOP et des coopératives aujourd’hui en France ? Encouragez-vous cette création ?
Oui, il se crée des coopératives et nous souhaitons qu’il y en ait davantage. Cela étant, être une coopérative signifie s’engager sur le principe « une personne égale une voix » à la place de « une action égale une voix ». C’est compliqué dans un monde imprégné d’une forte culture capitalistique, où c’est le capital financier qui détermine votre pouvoir de décision ou d’influence dans une entreprise.
Aussi je pense qu’il faut surtout tendre à poursuivre l’essaimage dans la société actuelle des valeurs coopératives et des valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui sont des valeurs de modernisation. Prenons quelques exemples : dans la plupart des entreprises, 90% à 95% des personnes ont des idées mais on ne les sollicite pas ; le principe de l’objectif individuel cultive la priorisation des intérêts personnels ; les salariés ne sont pas suffisamment associés aux décisions et intéressés au résultat collectif. Aujourd’hui, la jeune génération est en quête de sens. Les jeunes ont envie d’être associés au fonctionnement de l’entreprise, ils ont envie de plus de participatif. Je pense que cela va se développer ; il se trouve que les valeurs et pratiques historiques de l’ESS correspondent aux enjeux de la société actuelle et aux attentes des individus. Les résultats du Groupe Up témoignent que ces pratiques n‘altèrent en rien l’efficacité de l’entreprise.
Quel est votre rapport personnel à l’information et aux médias ? Comment vous informez-vous ?
J’écoute en permanence les informations. Mon réveil du matin, dès 6h, c’est la radio. Je commence en général par France Inter, avant de zapper sur d’autres chaînes, avec lesquelles je suis souvent en désaccord avec la ligne journalistique. C’est pour moi la seule façon de prendre le pouls des choses, d’entendre d’autres façons de penser les sujets de société. Avant, j’adorais dévorer la presse écrite. Avec la digitalisation, j’avoue avoir perdu l’habitude de la lire. C’est pourtant plus simple, plus accessible. Mais je ne prends plus le même plaisir qu’avec le papier. Il faut que je me réhabitue !
Vous qui avez fait des études d’économie et de finances, trouvez-vous que les médias sont suffisamment curieux d’économie et d’entreprise ?
Je trouve que les médias parlent de plus en plus d’économie, et traitent le sujet de mieux en mieux. Mais il y a trop souvent la recherche d’alimenter un côté anxiogène des informations économiques ou sociales. Les médias ont une responsabilité énorme sur la santé mentale de la population. C’est plus facile de parler des trains qui arrivent en retard plutôt que des trains qui arrivent quotidiennement à l’heure. Prenez le sujet de l’intégration : on préfère parler des 20% d’échec plutôt que des 80% de réussite. C’est là que Reporters d’Espoirs est important ! Si on n’offre que de l’information anxiogène, on crée une société avec une vision réductrice et protectionniste du monde. C’est donc essentiel de mettre plus en avant ce qui fonctionne. Si tu ne crois plus en rien, tu te désintéresses de tout et tu n’exerces plus ta citoyenneté.
Propos recueillis par Gilles Vanderpooten et Maëlle Widmann/Reporters d’Espoirs.
*Société Coopérative et Participative