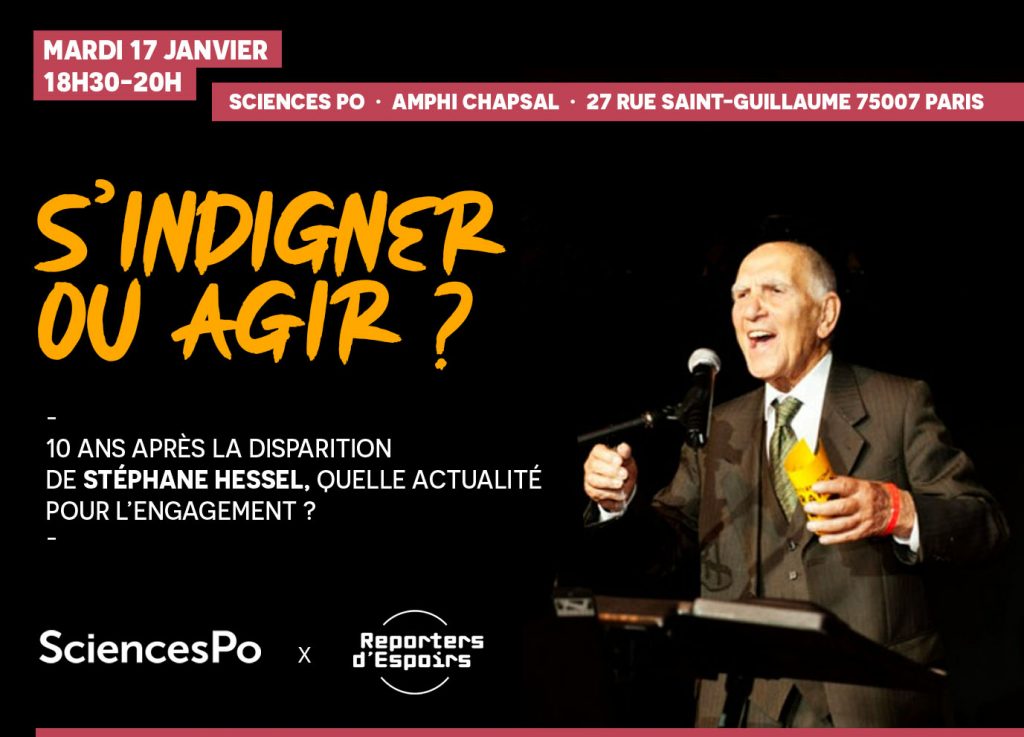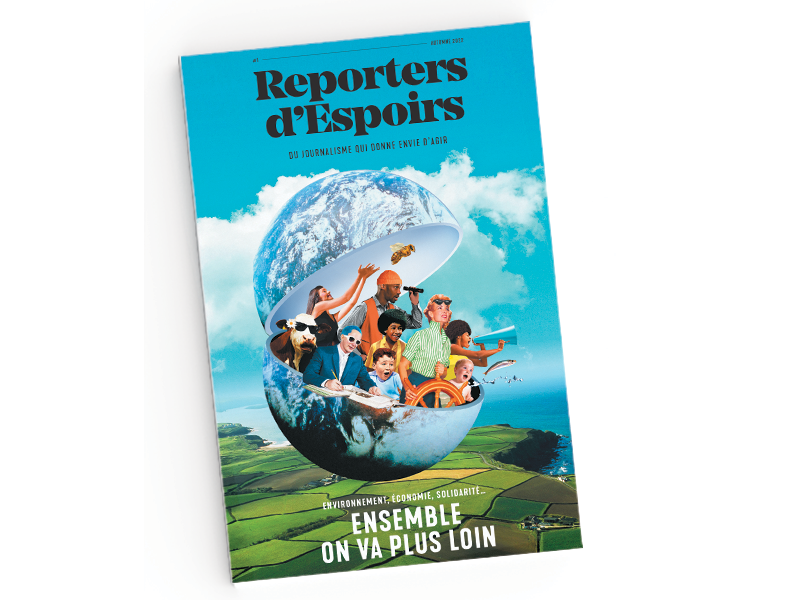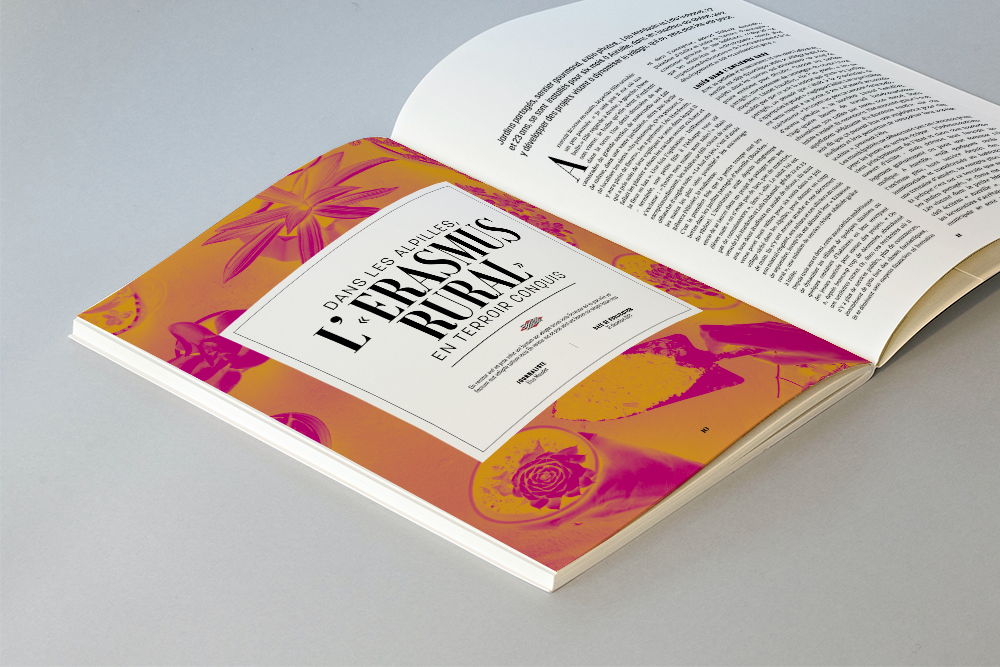« “C ce soir” est-elle déjà la meilleure émission de la télévision française ? » Un mois à peine après le lancement du nouveau programme de France 5, les chroniqueurs de « Capture d’écrans » sur France Inter interrogeaient son succès. Enfin une émission de débat qui fait la part belle aux idées, tourne le dos au clash et présente des intervenants qui s’écoutent mutuellement, comme on n’en avait plus vu depuis la fin de « Ce soir (ou jamais !) » en 2016. La faute à une culture journalistique de l’affrontement ? À un intérêt inavoué des citoyens pour la polémique ? À l’incapacité chronique qu’ont les gens d’écouter l’avis des autres, une fois donné le leur ? « C ce soir », qui a entamé sa quatrième saison, semble être parvenue à s’imposer comme l’une des rares émissions télévisées où il fait bon débattre. Attaché aux contenus médiatiques qui refusent la confrontation, Reporters d’Espoirs creuse la fabrique de cette émission avec Nathalie Darrigrand, Directrice Générale de Together Media.
Lancée en janvier 2021, l’émission « C ce soir », produite par Together Media – dirigé par l’ancienne directrice de France 5 Nathalie Darrigrand – emprunte à Etienne Klein son credo : Débattre, c’est argumenter pour ne pas se battre. Dans la lignée des programmes axés sur l’échange davantage que sur la confrontation, tels « Ce soir (ou jamais) ! » anciennement diffusé sur France 2 et France 3, ou « 28 minutes » toujours à l’antenne d’Arte, l’émission de France 5 incarne l’ambition de France Télévisions de « renforcer la place du débat d’idée sur ses antennes ». A la production éditoriale de l’émission diffusée du lundi au jeudi à 22h30, on y retrouve le producteur Benjamin Oulahcene, le rédacteur en chef Maxime Darquier et le présentateur Karim Rissouli – journaliste habitué à cet exercice complexe, animateur d’« En société » le dimanche à 18h30 et qui a précédé Thomas Snégaroff aux commandes de « C politique » à 20h.
À bord de ce navire composé d’une dizaine d’individus, deux chroniqueuses passées par la radio : la journaliste culturelle Camille Diao – qui anime l’émission le jeudi – et Laure Adler, ex-directrice de France Culture et « plus vieille influenceuse de France » selon ses propres mots. Les invités sont accueillis sur le plateau d’un studio parisien et échangent, pendant une heure et dix minutes en moyenne, sur des sujets qui fâchent : justice environnementale, cannabis, dissolution des Soulèvements de la Terre, pornographie… Il semble que « C ce soir » n’ait pas bâti sa réputation sur le consensus. D’autant plus intéressant, donc, d’analyser la manière dont toute l’équipe parvient (et parfois ne parvient pas) à garantir l’existence d’un véritable débat.
Un programme en évolution, des émissions toujours ciselées
Un sondage Ifop, conduit en juin 2021, indiquait que plus de 90% des répondants trouvaient le débat public trop conflictuel dans les médias. On parle de certaines émissions emblématiques du clash, on dit que les opinions se polarisent et que les Français ne savent plus s’écouter. « Les gens ne se parlent plus », affirmait Nicolas Daniel, directeur des magazines de FranceTV, à Télé-Loisirs en présentant le futur projet de France 5 produit par Together Media et porté par Karim Rissouli, « Voyage en territoire opposé » – une émission destinée à faire se rencontrer sur le terrain des personnalités aux convictions radicalement opposées, afin de créer de nouvelles possibilités de dialogue. Puisque plus personne ne s’entend, comment animer une émission d’idées, sur des sujets complexes, sans tomber dans le pugilat ? Selon Nathalie Darrigrand, tout tient dans la programmation minutieuse de chaque épisode. Le sujet du débat, souvent choisi la veille dans l’après-midi, est discuté tous les matins en conseil de rédaction, en fonction de l’actualité. Une fois fixé, c’est au tour du casting d’être mis sur la table. Qui inviter ? Qui mettre face à face ? Comment organiser le débat de telle manière qu’il y ait contradiction, sans que celle-ci ne se transforme en « foire d’empoigne » ? L’idée étant de doser la confrontation pour éviter à la fois la paraphrase et la défensive. Pas de recette miracle, cependant : il arrive que les mélanges ne fonctionnent pas, et que le clash s’invite sur le plateau.
« C ce soir » tournait à l’origine autour d’un grand invité, avec lequel le présentateur s’entretenait dans une première partie. Un temps de rencontre était ensuite organisé avec une personnalité liée à l’actualité, avant que d’autres invités ne rejoignent le plateau pour exposer leur point de vue, souvent divergent. La deuxième et la troisième saisons abandonnent cette structure en trois actes, pour se consacrer exclusivement à l’échange entre cinq ou six intervenants, la plupart étant des intellectuels et des personnalités engagées qui ont consacré un certain temps à réfléchir aux thématiques dont ils discutent. « L’idée n’est pas de faire une exposition professorale des points de vue, mais de créer une discussion animée et de faire émerger les nuances » affirme Nathalie Darrigrand. Dès le début de l’émission, Karim Rissouli, en alternance avec Camille Diao, donne les règles du jeu, résume les activités, l’expertise, et surtout les positions de chacun pour poser les bases de l’échange. Tout se fait dans les conditions du direct. Et le résultat est là : « France TV pourrait produire ce genre d’émission rappelle la Directrice Générale, [mais] elle continue de compter sur le savoir-faire [des] équipes de Together Media, fortes de leurs expériences sur d’autres émissions politiques [comme C Politique] ».
Un succès surveillé
Diffusée en deuxième partie de soirée, c’est-à-dire après les JT des autres chaînes, l’émission prend le risque d’une redondance avec les événements de la journée, qui constituent en même temps pour elle un ancrage. Si le public demeure captif de l’émission, si celle-ci est parvenue à s’imposer assez vite dans le paysage audiovisuel (environ 330 000 téléspectateurs chaque soir, selon Médiamétrie), si les commentaires sur les réseaux sociaux lui sont majoritairement favorables, c’est en partie parce qu’on y trouve un recul qui manque parfois ailleurs. « Il y a toujours la tentation de l’actu, reconnaît Nathalie Darrigrand. Or quand on y cède, ça ne donne pas forcément les meilleures émissions. Début juin, par exemple, le jour de l’attaque au couteau qui avait eu lieu à Annecy, nous nous étions posé la question de la pertinence d’un débat autour de ce drame. Mais c’était tellement omniprésent que nous n’avons simplement pas pu l’ignorer. Nous avons organisé un épisode à ce sujet, et nous avons reçu des retours selon lesquels ça n’était pas forcément une bonne idée. Ça n’était pas notre marque. Nous ne sommes pas une chaîne d’information en continu. » Il s’agit donc de bien doser, encore une fois. Suivre l’actualité, tenir compte des préoccupations du moment tout en conservant le recul de l’analyse à J+1 ou J+2. Cette programmation à flux tendu se répercute-t-elle sur la disponibilité des invités pressentis ? Selon Nathalie Darrigrand, les inquiétudes quant à une possible macrocéphalie parisienne dans ce choix ne sont pas fondées, la position géographique de l’invité ou le montant du billet de train pour qu’il puisse rejoindre le studio n’étant pas des critères.
Malgré le soin apporté au casting de l’émission, celle-ci ne peut se soustraire à une critique assez récurrente lorsqu’il s’agit du service public : un manque de pluralisme politique dans le choix des invités. Dans les entretiens qu’ils accordent, les membres de l’équipe s’en défendent toujours. Du fait de son statut particulier, le groupe France Télévisions a l’obligation légale de fournir un même temps de parole à toutes les mouvances, politiques notamment, élues – l’Arcom veille au grain. Mais au-delà de la contrainte juridique, la question se pose de donner la parole à toutes les mouvances, tout court. En somme, faut-il permettre à chacun de participer au débat public, au risque de promouvoir des discours minoritaires et extrêmes ? La productrice de « C ce soir » répond sans hésitation. « Notre cadre, c’est le cadre républicain. Nous n’invitons pas les gens qui ne le respectent pas, qui sont condamnés ou portent des propos haineux. » Suffit-il cependant d’écrémer à l’entrée pour éviter la violence et les attaques ad hominem ? Oui et non, sans doute : depuis plus de deux ans que « C ce soir » existe, l’émission a reçu les louanges des confrères et consœurs, malgré les quelques épisodes qui se sont soldés par un esclandre, esclandre dont d’autres médias se sont emparés comme de la fausse note tant attendue. « À être trop gâté, on en devient sans doute plus exigeant, au point même de relever quelques dérapages » écrivait Étienne Labrunie dans Télérama. Pas de quoi enterrer « C ce Soir », ni le débat public sur nos écrans.
Propos recueillis par Louise Jouveshomme