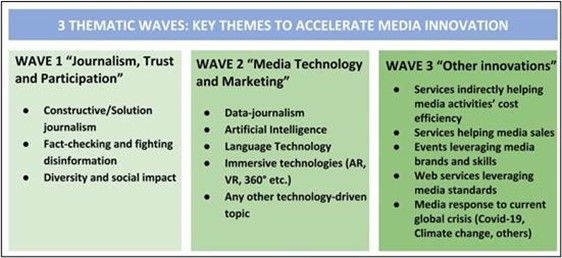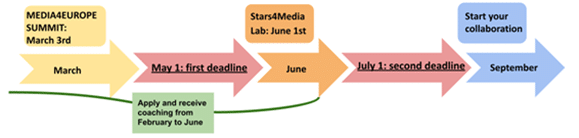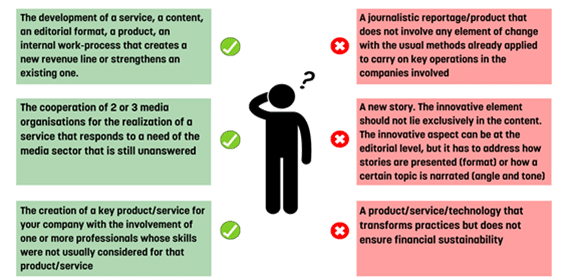« Je suis fermement convaincu que le journalisme c’est du terrain, du terrain, du terrain. Ce que je fais, c’est carte blanche, aléatoire : l’essence du journalisme. J’invite les candidats à faire de même. » Koenig
Le philosophe Gaspard Koenig revient d’un périple de quatre mois à cheval à travers l’Europe. Il nous fait le plaisir de rejoindre le jury du Prix Reporters d’Espoirs, et partage à cette occasion avec nous des rencontres qui l’ont fait évoluer, sa conception de l’Europe, de la liberté, et d’un journalisme qui prend le luxe de se laisser le temps.
Vous revenez d’un voyage de quatre mois à cheval, 2500 kilomètres à travers l’Europe, sur les pas de Montaigne qui avait entrepris le même chemin en 1580 – du Périgord à Rome, en passant par Meaux, ou Mulhouse. Vous aviez pour objectif de « faire revivre l’humanisme européen », l’avez-vous rencontré ?
L’humanisme européen, c’est assez vague comme projet de départ : « humaniste » parce qu’à la rencontre des gens. Mais c’est chemin faisant que les choses se précisent ou non. Or je n’ai pas trouvé de sentiment d’appartenance européenne sur mon passage. Dire qu’il existe une culture ou des idées européennes ne me semble pas très conforme à ce que ressentent les gens. Les Humanistes du XVIe siècle étaient européens, mais parler d’un « humanisme européen », au final, me semble surjoué.
Vous avez peut-être en revanche rencontré une certaine forme d’humanisme en rencontrant des gens ?
Oui, et il se caractérise pour moi par le fait qu’on arrive encore à voyager et à rencontrer des gens hors de tout schéma préétabli, hors de toute application, de toute chose planifiée. C’est là, en étant rendu à l’aléa, qu’on trouve une forme de liberté. Ça fait beaucoup de bien dans un monde de plus en plus normé, où il faut décliner son identité à tout bout de champ. Cette manière de voyager à cheval m’a affranchi de toutes ces procédures de contrôle.
Le fait de réaliser ce périple à cheval a-t-il apporté quelque chose de particulier en termes relationnels ?
A voyager à cheval, il est certain qu’on entre plus facilement en contact avec les gens. Les rencontres se font sur un pied d’égalité, et elles ne sont pas liées aux opérations d’un algorithme. Je suis parti avec des bagages très réduits pour des questions de poids, avec l’idée d’être constamment hébergé, comme un voyageur qu’on accueille gracieusement, sur un bout de canapé. Avec l’idée de prendre non pas les chemins noirs mais de rencontrer la modernité – celle des grandes villes, des banlieues, des nationales, d’Orléans, de Florence… et de provoquer dans cette modernité une forme de disruption, de trouble, qui redonne de la vie, apporte de la spontanéité.
C’était aussi plus facile de réaliser ce voyage à cheval. En effet, si vous arrivez en citadin, vous mettez des mois à franchir les barrières, les biais, les filtres, alors que là, comme cavalier, les gens ne vous demandent pas vraiment ce que vous faites. J’ai été accueilli dans une relation simple et d’égalité. De fait, j’ai cette possibilité d’être à leur table, de partager leur diner, de voir ce dont les gens parlent entre eux, sans biais d’observation.
Au terme de ce périple j’ai l’impression d’être moins « hors sol » qu’avant, d’avoir rencontré des gens très accueillants. La relation d’hospitalité comme la palette des relations humaine font apparaitre une conception à part, même si elle est éphémère puisque la relation est de courte durée. Elle est très claire en même temps que très forte. Je suis d’ailleurs encore en contact avec beaucoup d’entre eux.
Comment avez-vous vécu cette grande aventure à travers l’Europe ? Quel sentiment cette dernière a-t-elle suscité ?
En quatre mois et demi, je n’ai quasiment jamais rencontré d’hostilité. Le cheval inspire la sympathie, la confiance, l’idée de prendre soin de sa bête, ou encore un côté peluche de l’animal. C’est un moyen extraordinaire pour gagner les cœurs, aussi je partais avec un avantage. Traverser l’Europe tout seul, partout, y compris dans la banlieue de Meaux ensoleillée, cela permet un enrichissement intérieur exceptionnel ! J’ai également pu prendre du recul sur les gros titres des journaux et sur l’idée que la société serait au bord de l’explosion.
Montaigne voulait « parler aux gens de ce qu’ils connaissent », qu’en pensez-vous ?
Le biais des sondages est incroyable : quand on demande aux gens « vous sentez-vous abandonnés ? » ils répondent « oui », se conformant gentiment aux stéréotypes que l’on porte sur eux et notamment concernant ce qu’on nomme « la France périphérique ». Or les gens avec peu de revenus peuvent ne pas se sentir pauvres.
Je suis passé par la diagonale du vide. Ce ne sont pas les régions les plus riantes, pour autant les gens détestent qu’on s’apitoie sur eux, en leur nom ou même sur les plateaux télé. Ils veulent qu’on les laisse vivre. Le vrai ressentiment est lié à l’impression que « le centre » prend des décisions extrêmement détaillées qui ne correspondent pas au terrain. Ces êtres se sentent alors enfermés dans des univers normatifs trop complexes, presque intrusifs.
La demande générale reste la suivante : « laissez-nous vivre, on se débrouille bien, qu’on nous laisse gérer ». Tous les gens que je fréquentais étaient ou soutenaient les gilets jaunes. Une norme de plus – pour les gilets jaunes une nouvelle limite de vitesse sur les routes nationales-, quelle qu’ait été la norme, ça fait déborder.
Ce voyage vous a-t-il amené à changer de point de vue ?
Il y a énormément d’aspects sur lesquels j’ai changé. Notamment sur ma relation au travail manuel, à la question du low-cost, au droit des animaux ou encore aux zones pavillonnaires. Le réflexe libéral apparait parfois comme inhumain, surtout lorsque l’on s’aperçoit que ces choses ont été imposées par des politiques publiques, collectivités et industriels : la question du libre choix se pose totalement.
J’ai aussi évolué sur ma vision de l’Europe. L’humanisme, les valeurs européennes, c’est vraiment pour les bobos. La subsidiarité pour permettre aux gens de vivre leur régionalisme, c’est essentiel. Dire aux gens de Périgueux et de Limoges qu’ils appartiennent à la même région ; que les habitants de la Champagne ont les mêmes problèmes que les Alsaciens… c’est un jeu administratif qui n’a rien à voir avec l’ordre spontané !
Enfin, je pense désormais que chacun devrait pouvoir se replier sur son ile. Ce pourquoi je suis pour le revenu universel : retrouver son soi, pouvoir faire une pause. Avoir une coquille où se réfugier. Avoir son île pour d’autant mieux en sortir afin d’aller à la rencontre des autres.
Comment définiriez-vous le rapport des gens aux médias aujourd’hui ? Koenig
La presse régionale reste un média très puissant. Ecrivez un article dans la presse locale, vous êtes sûr que les gens vous reconnaitront. Alors que j’ai écrit des chroniques dans Le Point, jamais personne ne m’a interpellé là-dessus, j’étais totalement inconnu. Les thèmes abordés par les médias nationaux le sont assez peu sur le terrain.
Avez-vous des initiatives concrètes à partager, qui ont du sens et que vous avez appréciées, ici ou là ?
J’en ai croisé tout le temps. Hélas parfois, la loi ne leur permet pas d’aller au bout d’un projet que ce soit pour planter des haies ou pour les transports scolaires. Les personnes qui combinent des vies m’inspirent beaucoup : par exemple ce maréchal-ferrant, récoltant de mirabelles, qui faisait aussi du miel. C’est une combinaison d’activités qui fait que les gens trouvent des solutions pour eux-mêmes. Partout. J’ai pu faire la connaissance de néoruraux, des gens qui refont de l’artisanat, créent une épicerie, se lancent dans l’agriculture biologique…. Des chemins prometteurs que je n’avais jamais explorés auparavant. Koenig Koenig Koenig Koenig Koenig
On vous connait surtout comme philosophe et écrivain, moins peut-être comme éditorialiste – or vous prêtez votre plume, en tant que chroniqueur aux Echos et au Point notamment. Quel regard portez-vous sur le journalisme ?
Je me suis coupé de toute info pendant cinq mois. J’étais très heureux. Je savais vaguement ce qui se passait, sans pour autant passer à côté d’informations vitales. Je regardais The Economist le week-end, mais plus du tout les sites d’information en continu.
S’intéresser au monde oui, mais le faire par étape.
Comme Hegel et sa prière du matin, je me suis astreint à ne suivre les chaines d’information que le matin. Le truc qui rend fou, c’est d’être suspendu aux alertes. Cela a un effet tourbillon. Nous devenons hystériques sur des sujets qui ne nous concernent pas. Certes ça a toujours été l’idéal des Lumières que l’information circule. Mais le but n’est pas d’être abreuvé d’information. Il faut parfois se couper pour se retrouver sur ses propre désirs et projets, ne pas les confondre avec ceux de la planète. Koenig Koenig Koenig Koenig Koenig
Le caractère anxiogène du journalisme, c’est un sujet de préoccupation pour vous ?
L’aspect anxiogène de l’information semble être recherché aujourd’hui par les médias.
Je n’ai pas de carte de presse, mais j’ai l’impression de faire du vrai journalisme que je caractériserai par celui qui ne sait pas ce qu’il cherche. Comme disait Montaigne : « je sais ce que je fuis, pas ce que je cherche ». L’incroyable luxe de se laisser le temps, de changer de sujet, de se laisser guider par le hasard et l’évolution de sa propre réflexion, pour trouver un fil.
Comme Albert Londres errant des mois durant, sur de fausses pistes, le menant à Paris pour finalement trouver le sujet de son reportage à Buenos Aires… Il faut réhabiliter l’idée que le journaliste est envoyé sur le terrain en ayant « carte blanche », et qu’il doit être payé pour cela. Par sa rédaction – qui investit du temps, des pages, un photographe…- et par des lecteurs dont il est crucial qu’ils acceptent de payer. A mes yeux, l’idée que l’écrit devrait être gratuit sur écran, c’est la mort du journaliste, entrainé dans une course au clic et au trash où il finit par faire des posts sur twitter… Le New York Times ou Les Echos instaurent des paywalls : c’est absolument vital pour des raisons de fond.
Il y a des journalistes de news. Et il y a des reporters. La première chose que les journaux coupent en général ce sont les grands reportages. Or, s’ils font cela au bénéfice du commentaire d’actualité, ils suppriment ce qui fait leur différence et signent leur arrêt de mort. Albert Londres, à la fin de ses reportages, pouvait donner son opinion. Celle-ci était légitime parce qu’elle pouvait être incarnée au vu du parcours, et parce qu’il commençait par le fait.
Un conseil aux candidats au Prix Reporters d’Espoirs -notamment de futurs journalistes- que nous lançons, avec votre concours ?
Je suis fermement convaincu que le journalisme c’est du terrain, du terrain, du terrain. Ce que je fais, c’est carte blanche, aléatoire : l’essence du journalisme. Je les invite à faire de même.
Propos recueillis par Gilles Vanderpooten.
www.gaspardkoenig.com