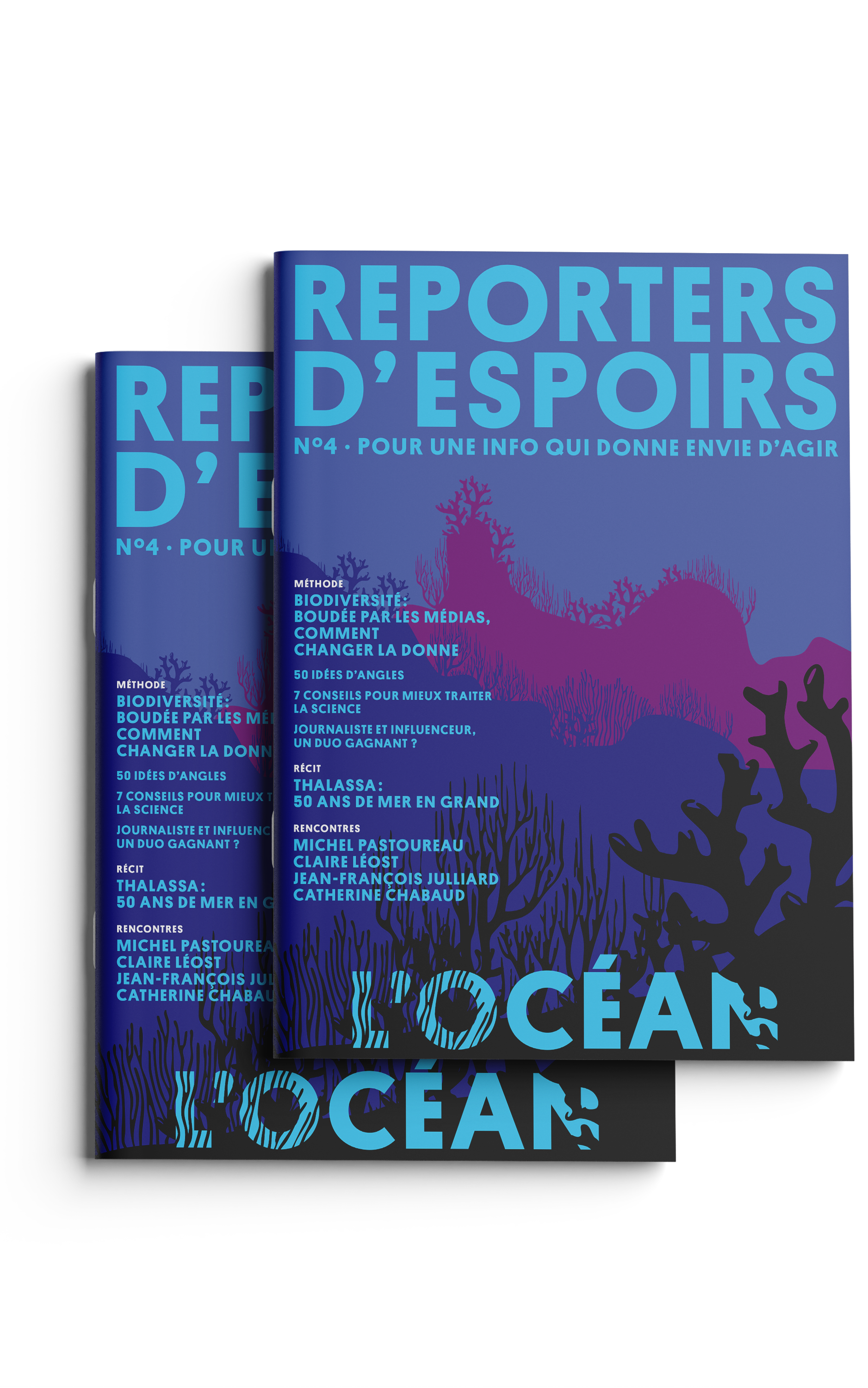103_BORN_IN_PPM__JACQUES_HUYBRECHTS_BD_©_MaryLou_Mauricio
A l’occasion de la 8e édition de l’Université de la Terre qui se tiendra les 14 & 15 mars prochains à l’UNESCO, nous avons interviewé Jacques Huybrechts, son fondateur. Présentant les enjeux abordés lors des conférences et tables rondes des deux jours, il revient sur la genèse de ce projet et sur l’importance qu’il accorde à fonder un modèle de société qui respecte le vivant.
Léa Varenne – Jacques Huybrechts, qui êtes-vous ?
Jacques Huybrechts – Je me décris comme un entrepreneur engagé. J’ai toujours mis le projet économique que j’ai porté au service de mes valeurs. C’est notamment pour cette raison que j’ai fondé l’Université de la Terre, qui célèbrera ses 20 ans lors de l’édition des 14 et 15 mars 2025 à Paris. Le Parlement des Jeunes est un autre de mes projets, que j’ai lancé en 2021. Il se tient tous les 2 ans et ressemble à une convention citoyenne de la jeunesse, composée d’un panel représentatif avec lequel nous travaillons sur les principales préoccupations des jeunes.
Qu’est-ce qui vous anime ?
Améliorer la vie de cette planète, à la fois personnellement et collectivement, avec mon équipe et tous ceux que nous embarquons dans nos aventures. C’est peut-être très ambitieux mais j’ai toujours pensé qu’on pouvait associer activité professionnelle et contribution à une meilleure société. Je suis animé par le fait de concilier le projet de mon entreprise et les valeurs auxquelles je crois, qui sont alignées sur les enjeux économiques et humains.
Il y a 20 ans, vous avez décidé de fonder l’Université de la Terre. Quel était votre objectif ?
C’est un projet que j’ai écrit bien avant, en 1992, quand je finissais mes études. A cette date, il y a eu un grand sommet de la terre, le Sommet de Rio, et ça a été pour moi une révélation. A cette époque, je n’étais pas particulièrement engagé sur les sujets écologiques. C’est grâce à ce sommet que j’ai compris combien nous allions dans le mur – et même que nous étions déjà dans le mur sur un certain nombre de critères écologiques. Le GIEC n’avait pas encore déployé son travail sur les questions climatiques, mais il y avait toutes les pollutions que l’on connaît aujourd’hui et je me suis dit : « il faut qu’il y ait une prise de conscience sur ces enjeux-là ». C’est de là qu’est venue l’idée de créer une Université de la Terre, pour en apprendre plus sur ces enjeux, apprendre à vivre différemment et ainsi lutter contre les dégâts causés par les humains depuis des siècles. En 1992, c’était trop tôt, parce que ça intéressait peu de monde à l’époque. J’ai donc laissé le projet dans les cartons et il a fallu deux rencontres pour qu’il voit le jour : une avec l’UNESCO en 2004 – qui cherchait un projet pour 2005 sur les 60 ans des Nations Unies – et une avec le fondateur de Nature & Découverte, François Lemarchand, qui était notre premier partenaire à l’époque. Aujourd’hui, nous en sommes à la 8e édition en 20 ans, mais ça n’a vraiment grandi qu’à partir de 2015, avec la COP 21 pendant laquelle nous avons été intégrés à l’évènement public. Dès lors, les enjeux sont devenus de plus en plus prenants et urgents.
Quel est votre rôle dans tout ça ?
Je suis un peu le chef d’orchestre, en animant le projet dans toutes ses dimensions : financement, programme, mobilisation du public. Il faut aller chercher de nouveaux publics, des néophytes, sur le sujet. Je passe aussi beaucoup de temps sur la partie de communication, puisque nous sommes dans un monde d’information et de communication. Au-delà de l’Université de la Terre, l’idée est de faire monter les sujets dans les différentes sphères sociales.
L’Université de la Terre 2025, Nature = Futur. Pourquoi ce thème ?
On voit bien que c’est une équation qui va être complexe à réaliser. Quand on parle de futur aujourd’hui, on valorise plutôt l’IA, le spatial, la transition numérique, et la nature est relayée à un 2e voire 3e plan. Il faut que le progrès intègre la question de la biodiversité et du vivant au cœur de son modèle dans les années à venir. Ces sujets ont été laissés de côté depuis la révolution industrielle, et nous arrivons au bout d’un modèle qui est prédateur et destructeur pour le vivant. Il devient urgent de réinventer un modèle dans lequel la nature a sa place. Ça ne signifie pas qu’il faut nier le progrès scientifique et technologique, qu’il faudrait opposer l’IA et le vivant. L’IA s’arrêtera peut-être avec la fin des ressources, qui fera que l’ère numérique va ralentir, mais il faut intégrer la nature au plus près de tous ces progrès, en prenant systématiquement le vivant en compte. C’est peut-être impossible de concilier les deux, je suis conscient de la complexité de cette question. Aujourd’hui nous ne pouvons pas dire aux 8 milliards d’êtres humains que nous allons arrêter le progrès scientifique et technologique et tout miser sur l’écologie. Mais ce que nous voulons faire, c’est bâtir un futur qui réintègre le vivant au plus près et au mieux.
Comment choisissez-vous les intervenants à l’Université de la Terre ?
C’est un processus qui prend plusieurs mois. Bien évidemment, les enjeux nous guident, et nous travaillons aussi avec tous nos partenaires et alliés, en interrogeant plusieurs parties prenantes. Je passe beaucoup de temps sur la programmation : je m’informe, je lis, je me nourris de tout ce que j’entends, de tout ce que je vois. J’essaye de voir un maximum de gens pour comprendre ce qu’ils font concrètement et ce qu’ils pourraient apporter. L’objectif est d’équilibrer entre les mondes scientifique, économique et politique. Par exemple, pour cette édition 2025, quelques élus locaux seront là pour illustrer le fait que la soutenabilité peut s’opérer sur le territoire à l’échelle locale.
Parmi les nombreux thèmes abordés, il y a l’économie, la biodiversité et les médias. Ce sont des axes qui méritent d’être regardés de manière transdisciplinaire tant ils sont imbriqués. Comment faire pour qu’ils cohabitent mieux ?
Il faut recréer du lien entre les enjeux. Kate Raworth, grande figure qui sera présente, a inventé la théorie du donut, schéma qui montre les limites planétaires qu’il ne faut pas dépasser, et différents planchers humain et social en dessous desquels il ne faut pas aller. L’idée est de réencastrer l’économie dans la société, la société dans ses limites planétaires, et replacer chaque discipline par rapport à ces enjeux majeurs. C’est la première fois que l’humanité est en capacité de s’auto-détruire. Il ne faut pas oublier que nous sommes une espèce parmi d’autres qui va souffrir considérablement dans les années à venir. On peut choisir de n’en avoir rien à faire, en se disant que toutes les espèces vont disparaître et nous avec. Mais si on prend conscience que le vivant est important, et qu’on a envie de le protéger, je pense qu’il faut essayer de recréer du lien entre tous ces sujets. L’économie doit réintégrer la question du vivant et la question climatique, et les mettre en priorité. Et quand je dis « vivant », je parle aussi de la réconciliation de l’humain avec lui-même, car la dislocation sociale rend incompatible le lien avec toutes les autres formes de vie.
Déjà en 2022, vous disiez que « notre défi collectif est d’ouvrir d’autres voies et un autre chapitre de la civilisation… ». Mais que faire face à la folie du monde qui nous détourne de notre but commun « redevenir terriens » comme vous le dites ?
Faire ce qu’on peut à son échelle, ce qui passe notamment par des changements de consommation. Choisir ce qu’on achète, ça nécessite une éducation, un effort, mais c’est un levier puissant pour changer la société. Le budget est parfois un frein, mais tout le monde peut avoir un impact. Aller dans la nature, comprendre le vivant, mieux le respecter, choisir ses déplacements… sont autant d’actions pour changer les choses. On peut agir par son vote aussi, bien évidement. Nous sommes dans une démocratie, préservons-la. On peut aussi rejoindre des ONG ou encore engager son entreprise dans des démarches de progrès. Il y a aujourd’hui un réseau de collectifs dans les entreprises, de salariés, de collaborateurs, qui essayent de faire bouger les lignes dans leur boîte. Et certains créent même leur propre structure avec une démarche d’impact très clairement annoncée.
Qu’est-ce que vous espérez des tables rondes et intervenant.e.s qui débattent ?
La vocation de l’Université de la Terre peut aussi se résumer ainsi : comprendre pour agir. Ce principe repose sur de l’information, de la précision, et donc un accompagnement de la connaissance pour aller un peu plus loin. Chacune et chacun de nos intervenants ont soit une expérience active sur ces sujets-là, soit des pistes d’actions. On leur demande donc d’être pragmatiques sur les solutions qui sont à disposition des citoyens ou des entreprises.
Qu’est-ce qu’il ressort de concret de l’Université de la Terre ?
D’abord des transformations personnelles. De nombreux participants, dont des patrons de grands groupes, nous ont dit que l’Université de la Terre avait changé leur manière de voir le monde. En 2025, nous lançons également un mouvement pour que les citoyens se reconnectent au vivant et à la nature. Il repose sur trois piliers que sont l’équilibre personnel, physiologique et psychique. On y retrouvera les questions de l’alimentation, du mouvement et aussi la reconnexion à la nature qui est un facteur d’équilibre physique et psychique. Cette opération, baptisée « 1, 2, 3, dehors », a pour vocation de porter un message fort : prendre conscience du vivant, de la nature, de ce qui nous entoure, c’est essentiel à notre bien-être. Ça va prendre du temps de changer les comportements, d’engager les citoyens pour qu’ils aillent vers la nature, mais c’est une opération concrète qui doit aussi amener les citoyens à la protéger grâce à une meilleure connaissance de celle-ci.
Dans son article Sortir de la sidération : 20 actions à mettre en place, Bon Pote suggérait d’« inonder la zone de (non) merde » pour reprendre les termes. Il fait référence à la tactique d’extrême droite qui consiste en « flood the zone with shit », ce que l’on observe sur les réseaux sociaux. Comment cela peut aboutir ?
Je crois qu’il va falloir une forte mobilisation. Pour le moment, nous sommes atones, les forces de progrès social et écologique sont sidérées face à ce qui est en train de se passer. Il n’y a pas de mobilisation alors que de l’autre côté ça se mobilise très fortement. Il faut donc que l’activisme se mette en place. On peut tous être activistes à sa manière. La mobilisation, il y a quelques années, a été très forte sur le climat et là il ne se passe plus rien. Un des thèmes de l’Université de la Terre est la radicalité positive : par exemple, face à la loi agricole, il y a un peu de mobilisation mais elle est trop faible. On est sidérés mais je pense que ça va monter, il va falloir que ça monte. Il y a des échéances importantes électorales en France, au niveau local et national, donc il va falloir monter au front, il faut agir.
Propos recueillis pas Léa Varenne pour Reporters d’Espoirs