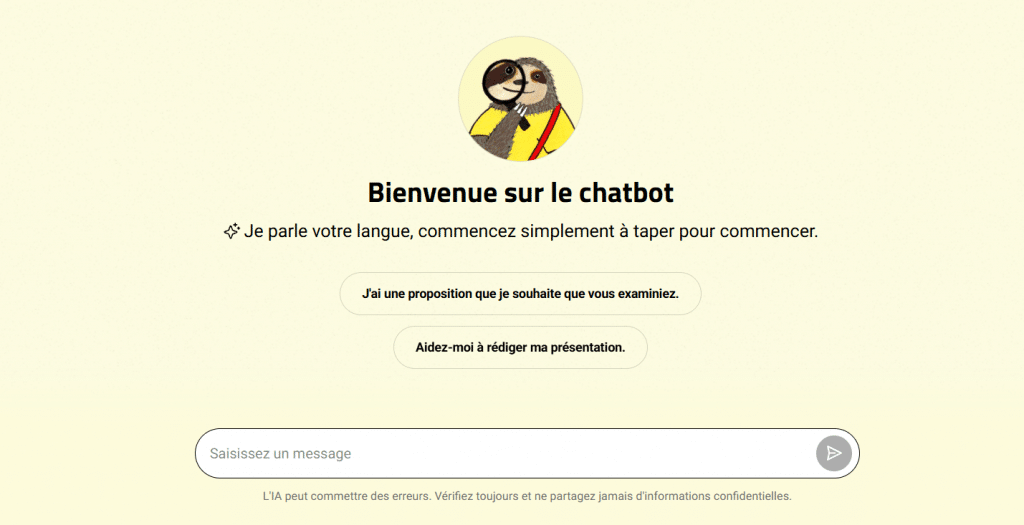A l’approche de la 3e Conférence des Nations unies pour l’océan (Unoc-3), qui se tient à Nice du 9 au 13 juin 2025, la rédaction de Nice-Matin prend le large. Avec « Les vigies de l’océan » elle propose une série de dix portraits de personnalités azuréennes. Skipper, apnéiste, océanographe ou photographe y racontent leurs passions, constats et espoirs. Objectif : parler de mer autrement. L’initiative mêle sensibilisation, participation citoyenne et journalisme de solutions. Explications par Sophie Casals, responsable des projets éditoriaux du journal.
Propos recueillis par Emma Baraban/Reporters d’Espoirs
photo : Sophie Casals interroge le biologiste et photographe Jean-Vincent Vieux-Ingrassia, l’une des dix vigies de l’océan, sur la plage de Beaulieu-sur-Mer. Crédit photo : Camille Devisi.
Emma Baraban : Comment est née cette série, et pourquoi avoir choisi de la construire autour de dix personnalités du monde marin?
Sophie Casals : Les grands sommets internationaux, comme celui de l’ONU sur l’océan, paraissent souvent lointains, techniques, voire déconnectés du quotidien. Aussi nous avons voulu rendre ce sujet plus proche, plus incarné. Comment parler de la mer à nos lecteurs ? Et surtout, comment le faire à partir de notre territoire, la Méditerranée, ses habitants, ses usages ? La réponse est venue naturellement : en donnant la parole à celles et ceux qui vivent la mer au quotidien, ici, sur nos rivages. Apnéiste, réalisateur, photographe, chercheur. Nous avons bâti une galerie de portraits à la fois variée et incarnée. Pas seulement des experts mais des voix capables de transmettre un attachement sensible, une émotion. On voulait parler à l’intellect et aussi donner à ressentir la mer, sa beauté, sa fragilité. Chaque entretien commence par une entrée intime : comment est née leur passion pour la mer ? Ensuite, on les amène vers les menaces qu’ils perçoivent et les solutions qu’ils imaginent.
Votre série adopte une posture constructive. Pourquoi ce choix ?
Nous faisons du journalisme de solutions depuis bientôt dix ans chez Nice-Matin. Cela ne veut pas dire qu’on nie les problèmes : au contraire, on les documente avec précision. Mais on sait que le constat seul ne suffit plus. Trop d’informations anxiogènes finissent par détourner les lecteurs. Pour qu’ils restent engagés, il faut leur donner le sentiment qu’ils peuvent, à leur échelle, avoir prise sur les événements. Nos vigies alertent sur la pollution plastique, la surpêche, la dégradation des petits fonds… Mais on ne s’arrête pas là. On leur demande aussi de formuler des propositions, de raconter ce qu’ils font déjà, et ce qu’ils attendent des décideurs, notamment à l’approche du sommet. Mieux consommer, mieux se déplacer, s’engager localement, se reconnecter à la mer. On ne minimise pas mais on ne désespère pas.
Pour aller plus loin, nous avons lancé, en parallèle, l’initiative participative « Ma proposition pour l’océan ». On a demandé aux lecteurs ce qu’ils proposeraient s’ils étaient à la table des décideurs. Et là encore, surprise : plus de 300 contributions, d’une grande qualité, venues de lecteurs de 15 à 80 ans, parfois très documentées. On a senti une attente forte : être écouté, pris au sérieux, participer.
Comment articulez-vous cette série avec le sommet de l’UNOC ?
Nous avons souhaité travailler en amont du sommet. Préparer le terrain, sensibiliser les lecteurs avant que l’actualité ne soit prise en charge par la couverture plus classique – les discours, la signature des traités. Pendant plus de deux mois, on a publié un portrait par semaine. À cela s’ajoutent un documentaire et une soirée de projection avec nos abonnés et les vigies. Tout cela pour inscrire les grands enjeux du sommet dans une réalité locale, concrète, méditerranéenne.
Nice-Matin est un média local, ancré sur une façade maritime. Cela nous donne une responsabilité particulière : ici, la mer est tangible, vécue. C’est un espace commun. Et lorsqu’on a demandé ce qui préoccupait nos lecteurs et leurs idées pour protéger la Méditerranée, ils ont répondu avec précision : pollution plastique, sur-tourisme, bétonisation du littoral et aussi création d’aires marines protégées, école de la mer itinérante, robots nettoyeurs pour les ports… Ce sont des enjeux à la fois locaux et globaux, qui figurent dans les priorités du sommet. C’est aussi pour ça qu’on a voulu exposer leurs propositions dans notre espace à l’UNOC. Il y aura les portraits de nos vigies et les contributions citoyennes les plus plébiscitées par les lecteurs – qui votent. On veut que ces paroles locales pèsent. Montrer que ce qui se dit ici a sa place dans un débat international. Et on souhaite que nos lecteurs, en retrouvant leurs préoccupations dans l’agenda du sommet, se sentent pleinement légitimes à participer, à s’exprimer, à interpeller. Un lecteur bien informé est un citoyen plus exigeant. C’est aussi ça, notre rôle.
Ce projet a-t-il changé votre regard sur le métier de journaliste ?
Oui. Il nous rappelle qu’on ne peut pas se contenter de transmettre des faits. Il faut aussi parler au cœur, montrer ce qui est beau, pas seulement ce qui est abîmé. Le biologiste et photographe Jean-Vincent Vieux-Ingrassia révèle aux lecteurs la vie insoupçonnée des petits fonds marins. Il montre qu’il y a de la vie dès les premiers centimètres d’eau. Ce type de récit surprend, émerveille, change les regards – et, parfois, le rapport à l’environnement.
Ce projet renforce aussi notre conviction : le journalisme de solutions n’est pas un supplément. C’est une manière responsable d’informer, d’impliquer, de relier. Si l’on désespère nos lecteurs, on désespère aussi leur capacité à agir, à voter, à se sentir concernés.
Enfin, on croit de plus en plus au journalisme participatif. Sur des sujets très concrets comme l’océan, associer les lecteurs permet de mieux comprendre les enjeux locaux, de recueillir leurs préoccupations et de valoriser leurs idées. Ils répondent présents. Et ils veulent être partie prenante de l’information.
Découvrez la série “Les vigies de l’océan” sur le site de Nice-Matin