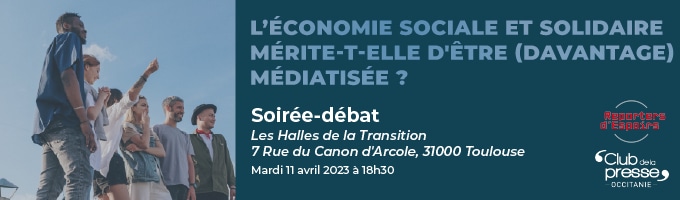Sophie Douce, journaliste indépendante
Sophie Douce est une journaliste passionnée par la région du Sahel. Son expérience en tant que correspondante pour Le Monde Afrique et Ouest France au Burkina Faso a renforcé son intérêt pour la couverture de cette région souvent négligée. Son engagement pour le journalisme de solutions et sa volonté de mettre en lumière les histoires des communautés marginalisées font d’elle une voix inspirante dans le paysage médiatique. À tel point qu’elle a remporté le Prix Reporters d’Espoirs Radio 2022 pour un podcast paru sur… L’Express !
Ecouter le podcast de Sophie Douce, Prix Reporters d’Espoirs Radio 2022 : https://www.lexpress.fr/economie/medias/podcast-le-777-la-bonne-etoile-des-bergers-burkinabes_2155343.html.
Qu’est-ce qui vous a amenée au journalisme ?
J’ai commencé petite, par tenir des journaux de bord et des carnets de voyage. Le besoin déjà, de raconter, de décrire le monde qui m’entoure, de coucher sur le papier pour décrypter et essayer de comprendre. Puis cette envie d’ailleurs, d’aller voir plus loin, comment on vit sur d’autres continents. J’ai alors découvert les documentaires de voyage et les récits d’aventure, qui me fascinaient. Très vite, le rêve de devenir journaliste a commencé à grandir. Comme beaucoup, c’est le mythe du grand reporter, du journaliste caméléon, qui m’attirait. Pouvoir vivre mille vies en une, parcourir des pays, rencontrer des personnes qu’il ne m’aurait certainement été impossible de voir sans le prétexte du micro tendu. C’est un métier merveilleux, pouvoir faire parler les gens, ils nous ouvrent des bribes de leur vie, on crée du lien. Celui d’être un « passeur d’histoires », entre deux continents, des cultures et classes différentes.
Comment vous informez-vous ?
Je commence mes journées par une revue de presse de l’actualité de ma zone de travail, le Sahel. Je suis la presse internationale spécialisée, Le Monde Afrique, RFI, Jeune Afrique… J’aime aussi beaucoup acheter les journaux locaux, il y a une vraie culture de la presse d’investigation au Burkina Faso, avec des bimensuels de grande qualité. Je reçois des alertes par mail, par mot clé (« Burkina Faso », « Sahel »), puis je consulte les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les groupes WhatsApp… C’est assez fastidieux et chronophage, mais ça me permet de m’imprégner des questions qui font débat et j’y puise souvent des idées de sujets. J’essaie aussi de garder un œil sur l’actualité française et internationale, avec des contenus plus posés, des analyses, des reportages colorés. J’aime regarder aussi les nouveaux formats qui se créent, les webdocumentaires, les podcasts.
Pourquoi le Burkina Faso ?
J’ai choisi de m’installer au Burkina Faso en 2018, après mon stage de fin de master en école de journalisme, que j’ai réalisé à Reuters TV, à Dakar au Sénégal. Je n’ai pas étudié l’histoire du continent, la richesse de ses royaumes et ses empires, le passé douloureux de la colonisation à l’école. Nous avons une histoire commune forte, pourtant on connait si mal ce continent. Il me semblait que l’on parlait à la télévision de « l’Afrique » souvent avec le même prisme, à travers les conflits, les famines, les troubles post électoraux.
Ce continent me faisait peur et rêver à la fois. J’étais pleine de fantasmes et de préjugés. Il me semblait qu’il y avait là-bas des histoires que nous ne racontions pas. Des récits oubliés, effacés. Je voulais m’y installer pour apprendre, pour suivre l’actualité d’un pays au long court, plutôt qu’en faisant des allers-retours.
J’ai contacté plusieurs rédactions parisiennes à la recherche d’un poste de correspondante dans la région. Le Monde Afrique était intéressé par des reportages au Burkina Faso. Je ne connaissais pas ce pays, j’avais entendu parler de son insurrection populaire, de l’ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, de la richesse de sa culture et ses valeurs de tolérance et d’hospitalité. Et je suis partie, avec une petite valise, un carnet et mon appareil photo. J’y suis restée cinq ans. Ce sont les Burkinabè qui m’ont tout appris.
Comment décririez-vous la situation actuelle au Burkina Faso ? Quels sont les principaux défis auxquels la population est confrontée ?
La situation est très préoccupante… Les attaques des groupes terroristes sont quasi quotidiennes. Plus de 10 000 personnes ont été tuées depuis le début de l’insurrection djihadiste, en 2015. Une grande partie du territoire échappe au contrôle des autorités. Les violences ont provoqué une grave crise humanitaire, deux millions de personnes sont déplacées, un Burkinabè sur dix souffre de la faim. Les civils sont les premières victimes des violences. Face à l’insécurité, l’armée a pris le pouvoir, deux coups d’Etat ont eu lieu en 2022. La junte mène depuis des opérations militaires offensives et impose une propagande dans la lutte contre le terrorisme. La liberté de la presse et d’expression sont menacées.
En tant que journaliste, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour couvrir les événements récents au Burkina Faso ?
Les difficultés sont nombreuses pour les journalistes restés sur place. D’abord la contrainte sécuritaire, il est très difficile de sortir de la capitale à cause du risque d’enlèvement et d’attaque des groupes terroristes. Très peu de journalistes peuvent se déplacer sur le terrain.
Puis le climat de peur qui s’est progressivement installé depuis les deux putschs en janvier et septembre 2022. La crainte des sources au téléphone d’être écouté par les djihadistes mais aussi d’être surveillé par les autorités. Il y a des pressions directes des autorités, des rappels à l’ordre contre ceux qui contrediraient la propagande officielle. Des activistes ont été arrêtés. Des journalistes ont été convoqués pour des recadrages. Plusieurs ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux par les soutiens des militaires. La junte a suspendu la diffusion de RFI et France 24. Nous avons été expulsées, en moins de 24 heures, avec Agnès Faivre, ma consœur du journal Libération, le 1er avril dernier, sans aucun motif. Des campagnes de dénigrement et de désinformation sont menées sur les réseaux sociaux contre les médias français, dans un contexte de tension avec l’ancienne puissance coloniale, la France.
Quelles sont les histoires les plus marquantes que vous avez couvertes au cours de votre séjour au Burkina Faso ?
Beaucoup de visages… Mon premier reportage, sur la veillée nocturne des femmes pour puiser de l’eau aux fontaines de leur quartier, faute de robinets fonctionnels chez elles, ce médecin qui « répare » les jeunes filles, victimes d’excision, ce paysan qui lutte contre la désertification qui grignote ses terres arides, ces veuves de militaires tués au front lors des opérations antiterroristes, et aussi, tous ces artistes, des metteurs en scène, des danseurs, des cinéastes, qui continuent de créer, pour résister.
Comment pensez-vous que les médias peuvent aider à apporter des changements positifs dans des pays en difficultés politiques, économiques et sociales comme le Burkina Faso ?
Je crois que dans un contexte de crise, le journaliste a avant tout un rôle d’alerte, de « réveilleur des consciences ». Il doit porter la voix des victimes des tueries, des conflits, des injustices. Mais au-delà de la guerre, plutôt que de compter les morts, les attaques, j’ai envie de raconter surtout, la vie qui continue malgré tout, souvent loin des projecteurs. Parler de ceux que l’on oublie, qui subissent ou qui résistent, qui construisent quand tout s’effondre, qui créent pour ne pas se résigner, qui s’efforcent de rêver, pour ne pas désespérer. Mettre des visages, raconter leur histoire. Au Sahel, la guerre est complexe, de plus en plus désincarnée. Il y a une fatigue des récits purement sécuritaires, je crois qu’il faut tenter de changer de narratif.
Je crois aussi à la fonction sociale du journaliste, qui peut créer des ponts, tisser des liens entre les peuples. Quelle chance nous avons de pouvoir parler à une multitude d’acteurs, accéder aux différentes strates de la société, des salons feutrés des gouvernants, aux paysans dans leur champ, pouvoir rentrer dans l’intimité d’un foyer, parler aux nantis mais aussi aux plus démunis. En portant leur voix, en transmettant des images, des émotions, certaines histoires peuvent toucher et faire bouger les lignes. Peut-être transmettre un souffle d’espoir ou inspirer certains.
Le journalisme de solutions est de plus en plus populaire. Qu’est-ce que cela signifie pour vous et comment pensez-vous que cela puisse aider à résoudre les problèmes dans des pays tels que le Burkina Faso ?
C’est tenter de poser un regard optimiste et bienveillant, sans complaisance ni naïveté bien sûr, mais en s’efforçant de se dépêtrer du cynisme ambiant, omniprésent lorsque l’on couvre des drames. C’est essayer de cultiver une capacité d’étonnement, de curiosité pour des sujets qui a priori ne nous intéressent pas, chercher à apprendre sans cesse, penser contre le narratif dominant. Choisir de faire un pas de côté des événements, prendre un chemin inverse quand les caméras se rivent vers un point convergent. C’est le pari de l’audace, face à la facilité.
Comment choisissez-vous les histoires que vous couvrez dans le cadre du journalisme de solutions et comment vous assurez-vous de présenter des solutions crédibles et efficaces aux problèmes que vous identifiez ?
La presse nationale au Burkina Faso regorge d’idées de sujets d’initiatives pratiques et originales. C’est une mine d’idées de reportages. J’aime beaucoup aussi me promener, discuter avec les gens au marché, dans les kiosques à café. La rue, un espace de vie et de travail central dans ce pays, est pour moi une grande source d’inspiration.
Je choisis mes sujets selon leur pertinence et leur impact sur les problèmes confrontés. Je mène toujours ma contre-enquête pour connaître, au-delà du projet présenté, la perception des gens autour.
Comment fonctionne le statut de journaliste indépendante ?
J’ai le statut de journaliste pigiste, je collabore avec plusieurs médias, principalement Le Monde, mais aussi régulièrement avec le quotidien régional Ouest-France, qui accorde une grande place à l’actualité internationale, et le magazine L’Express. Pour vivre de ce métier, les correspondants sur le continent travaillent la plupart du temps pour plusieurs médias. En cas d’actualité dite « chaude », il arrive que d’autres médias plus généralistes nous appellent pour un papier ou une intervention ponctuelle. J’aime beaucoup cette liberté, de pouvoir choisir mes sujets et jongler avec les formats et les angles.
Pourriez-vous nous raconter dans les grandes lignes l’histoire que vous abordez dans votre podcast qui vous a valu le prix Reporters d’Espoirs 2022 ?
Ce reportage a été réalisé dans le cadre d’une série lancée par l’hebdomadaire « L’Express », intitulée « Horizons africains », sur des initiatives innovantes utilisant les technologies satellites, des drones ou l’énergie solaire pour améliorer le quotidien des populations sur le continent.
La rédaction m’a proposé de réaliser un reportage sur la plateforme « Garbal », un outil original et concret qui aide les éleveurs au Sahel à s’adapter, face à la désertification et à l’insécurité qui entravent leurs déplacements. C’est une plateforme d’appel qui permet aux paysans de consulter la météo, localiser les pistes de transhumance sécurisées, les points d’eau pour les animaux, etc. Je suis très heureuse que ce prix mette la lumière sur la condition des éleveurs nomades de la région et contribue, surtout, à poser un autre regard, plein d’espoir, sur la crise au Sahel, où l’avenir ne cesse malheureusement de s’assombrir. Dans la région, les éleveurs font partie des premières victimes de l’insécurité, des conflits et de la sècheresse.
Propos recueillis par Sixtine Guellec.