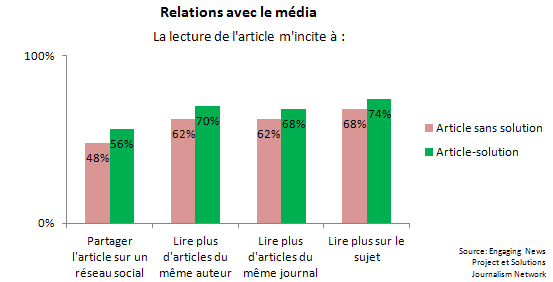L’école de journalisme de Windesheim (Pays-Bas) est la première école au monde à intégrer le journalisme constructif dans ses programmes de formation et de recherche.
La journaliste danoise Cathrine Gyldensted, pionnière dans le domaine, a été nommée directrice de la spécialité à Windesheim. Elle a pour mission d’intégrer les techniques du journalisme constructif au cursus existant et de développer un cours d’approfondissement. « J’ai formé des étudiants et des salles de rédaction au journalisme constructif dans le monde entier, mais c’est à Windesheim que la démarche suscite le plus d’intérêt » s’enthousiasme la nouvelle directrice, chargée d’établir des partenariats avec les écoles de journalisme, les universités et les organes de presse intéressés par cette nouvelle approche. « Je pense que le journalisme doit refléter la société d’une manière plus authentique, il faut innover dans la façon de couvrir l’actualité, gagner la confiance et véritablement s’engager au service du public. »
« Cathrine Gyldensted a refusé des propositions aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Scandinavie pour enseigner à Windesheim, nous sommes très fiers de l’avoir à nos côtés » témoigne Bas Mesters, le directeur de l’école de journalisme de Windesheim. « Son expertise du journalisme constructif est reconnue au niveau international, elle apporte une réelle plus-value à notre cursus et au travail de recherche. »
Selon Bas Mesters, s’intéresser au développement de nouveaux business modèles et aux plateformes numériques n’est pas suffisant, un ajustement de la posture journalistique est nécessaire. « Le journalisme fait face à une crise de légitimité. La recherche montre que la confiance du public vis-à-vis de notre profession est au plus bas. Je pense que cette situation peut évoluer si le journalisme change d’angle au lieu de se concentrer exclusivement sur les problèmes et les conflits. Il s’agit simplement d’ajouter les éléments manquants qui permettront de renforcer l’exactitude et la justesse du journalisme, son engagement au bénéfice des citoyens et sa légitimité. Nous avons déjà reçu un grand nombre de demandes de médias qui veulent inclure ces éléments constructifs à leur ligne éditoriale. »