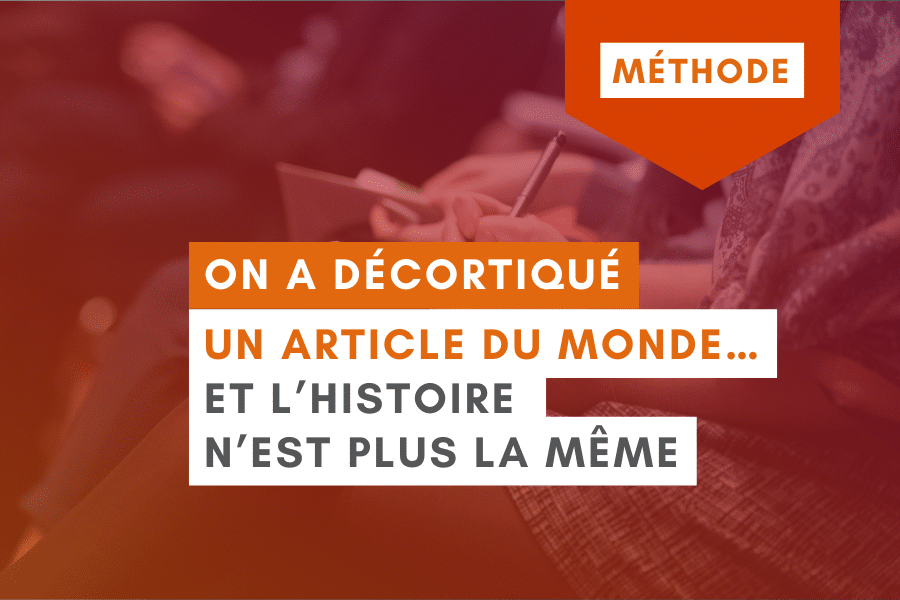
Voici ce que devient un article d’alerte du média Le Monde quand on le relit avec l’œil des solutions
Vous avez sans doute vu passer cet article du média Le Monde avec AFP , daté du 13 novembre 2025 : « La santé des agents de nettoyage est fortement affectée par leur travail, selon une étude de l’Anses« .
Un papier bref et précis qui rappelle, sans détour, la réalité quotidienne de milliers de personnes. Les agents de nettoyage travaillent avec des produits irritants, répètent des gestes qui fatiguent les articulations, interviennent souvent seuls et à des horaires décalés, avec des journées éclatées. La sous-traitance ajoute une pression supplémentaire en réduisant les temps d’intervention et en augmentant les cadences. L’Anses observe un taux de maladies professionnelles et d’inaptitudes deux fois plus élevé que dans le reste du salariat et recommande de repenser la prévention, les formations et l’organisation du travail, en particulier en encourageant le nettoyage en journée.
L’article pose le décor sans détour. Mais ce décor appelle une autre question. Que deviendrait ce sujet si on le relisait à travers une approche qui cherche non seulement à comprendre ce qui abîme, mais aussi ce qui, quelque part, commence à réparer? C’est exactement le principe de la démarche journalisme de solutions.
Partir du diagnostic mais l’orienter autrement
Le point de départ reste le même que celui du Monde : conditions difficiles, risques multiples, organisation du travail qui accentue la pénibilité.
La différence se joue sur un point simple : plutôt que de s’arrêter au constat, on s’en sert comme tremplin pour chercher ce qui a déjà été essayé ailleurs et comprendre ce que ces tentatives ont donné.
Par exemple, on peut s’interroger de la manière suivante :
- Où observe-t-on des organisations qui ont réduit les troubles musculo-squelettiques?
- Quels sites ont testé le nettoyage en journée et qu’est-ce que cela a changé?
- Quels produits ou méthodes ont permis de diminuer les irritations?
- Quels acheteurs ont modifié leurs contrats et obtenu des effets sur le terrain?
Le problème reste entier, mais il devient un point de départ plutôt qu’un mur.
Chercher ce qui se passe déjà, même à petite échelle
Une fois les questions posées, la première étape consiste à repérer les lieux où quelque chose bouge.
- Cela peut être une collectivité qui a regroupé les horaires pour éviter les journées en trois morceaux.
- Cela peut être une équipe qui a remplacé les produits les plus agressifs.
- Cela peut être un site pilote qui utilise du matériel plus ergonomique.
- Cela peut être un client qui a revu son cahier des charges pour exiger un minimum de continuité horaire.
Dans beaucoup de secteurs, les solutions ne naissent pas sous la forme de grandes réformes. Elles prennent la forme de petits ajustements qui modifient progressivement le quotidien.
Définir clairement les terrains où enquêter
Une enquête orientée solutions a besoin de repères solides. Sur ce sujet, trois terrains s’imposent naturellement.
- Organisation du travail.
- Exposition et prévention.
- Commande et sous-traitance.
Ces terrains donnent un cadre clair à l’enquête et évitent de se disperser.
Identifier des initiatives et vérifier leurs résultats
Le journalisme de solutions ne consiste pas à chercher de jolies histoires. Il consiste à vérifier ce qui fonctionne.
Pour chaque réponse repérée, il faut se demander:
- Existe-t-il des données avant et après?
- Qui les fournit?
- Les agents confirment-ils l’amélioration?
- Qu’est-ce qui n’a pas marché?
- Qu’est-ce qui a fonctionné seulement partiellement?
Une initiative sincère n’est pas forcément une solution. Une initiative qui produit des effets, même modestes, commence à le devenir.
Examiner les limites pour comprendre les conditions de réussite
Il n’existe aucune transformation sans tension. Les limites doivent être mises sur la table.
Certains sites ne peuvent pas basculer en journée sans renoncer à la co-activité. Certains budgets d’achat ne permettent pas d’investir dans du matériel plus ergonomique. Certains donneurs d’ordre restent attachés à une logique de prix qui fragilise mécaniquement les prestataires.
Regarder les limites ne revient pas à dénigrer les initiatives. Cela permet de comprendre ce qui rend une solution viable.
Tester la reproductibilité pour passer du cas isolé à l’enjeu collectif
C’est le moment crucial. Une bonne pratique locale n’a de valeur journalistique qu’à condition d’examiner sa capacité à vivre ailleurs.
Cette étape demande de distinguer ce qui est transposable de ce qui dépend d’un contexte trop particulier, trop spécifique parfois pour être essaimé. Elle invite aussi à identifier les acteurs nécessaires pour élargir l’expérience, que ce soient les équipes, les donneurs d’ordre, les prestataires, ou les responsables de site.
C’est là que le reportage prend une dimension plus large et quitte le terrain de l’anecdote.
Ce que donnerait l’article du Monde relu avec cette méthode
On garderait l’alerte, la rigueur et la précision du texte original. On y ajouterait une deuxième lecture, centrée sur ce qui se tente déjà : les réorganisations engagées ici ou là, leurs effets mesurés, leurs limites, et les conditions nécessaires pour qu’elles cessent d’être des exceptions.
L’article pourrait alors basculer vers un angle comme :
« La santé des agents de nettoyage se dégrade fortement, mais certaines entreprises prouvent qu’on peut organiser le travail autrement. »
Même sujet. Même gravité. Mais une manière d’écrire qui ne s’arrête pas au problème et met au jour ce qui permet de progresser.
Et pour le lecteur, cela change la perspective : au lieu de se retrouver face à un constat immobile, il accède à des pistes concrètes, à des résultats vérifiables et à des leviers d’action qui éclairent réellement le débat.
Aller plus loin : Le Mooc Journalisme de Solutions










